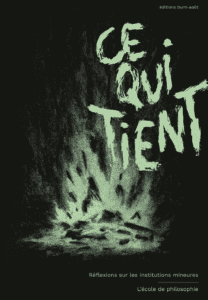#71 – Ce qui tient : du devenir, de la praxis, du collectif – L’École de philosophie
proposée par Corinne Leconte
Diffusée le 5 novembre 2025
Le devenir minoritaire comme figure universelle de la conscience s’appelle autonomie.”
[…] Bien sûr, les minorités sont des états définissables objectivement, états de langue, d’ethnie, de sexe, avec leurs territorialités de ghetto; mais elles doivent être considérées aussi comme des germes, des cristaux de devenir, qui ne valent qu’en déclenchant des mouvements incontrôlables et des déterritorialisations de la moyenne ou de la majorité.”
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux. cité p.92 et p.95L’hexis corporelle désigne la façon dont l’habitus informe jusqu’à notre corps. La philosophie comme pratique de langage apparaît ainsi aussi comme une technique du corps.”
Bourdieu, Ce que parler veut dire, cité p.36En d’autres termes, il n’est pas vrai qu’une « position subjective » préexiste à l’énonciation qu’elle occasionne, car certains types d’énonciations démantèlent les « positions subjectives » mêmes par lesquelles elles sont apparemment rendues possibles.”Judith Butler,Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe ». cité p.41
Contexte
La présentation de CE QUI TIENT, livre collectif paru aux éditions Burn~Août, a été enregistrée au Merle Moqueur, Librairie à Paris (20).
William F. et Camille S. évoquent l’École de philosophie, la genèse et le sujet de l’ouvrage collectif CE QUI TIENT, sous-titré “RÉFLEXIONS SUR LES INSTITUTIONS MINEURES“. Trois grandes notions antagonistes structurent les nombreuses contributions des philosophes praticien.nes réuni.e.s ici, et du groupe L’envers du langage. En effet, au cours de la quatrième année de l’école, ielles décident de réunir des contributions écrites sur leur pratique et leur recherche communes et singulières, en les organisant en trois grandes parties : 1. parler / se taire – 2. apprendre / ignorer – 3. Instituer / destituer. L’école de philosophie est une formation autogérée qui accueille une quarantaine de personnes par an. À l’école, on lit des textes, on fait la vaisselle, on écoute des exposées, on parle, on parle beaucoup, on regarde des films, parfois on joue à des jeux, on fait des exercices en petits groupes, on se ballade, on se casse la tête et on aime ça.
Ensuite, Ghislain C. développe ce qu’est une institution et a fortiori une institution mineure, ébauchant une histoire de la philosophie non pas comme énoncé mais comme énonciation et ce que raconte les conditions d’une énonciation, p.99 : Résumons. Il y a du majeur et du mineur dans toute institution. Usage et norme fonctionnent en cercle. Cependant, dans ce cercle, retenons que majoritaire signifie État ou état (constante) et minoritaire, devenir (variation). L’institution majeure normalise les usages pour étendre l’empire de la constante. L’institution mineure use de la norme pour faire proliférer des variations. L’institution minoritaire n’est donc pas une petite institution, ni une institution marginale ou alternative. L’institution minoritaire est une institution en mouvement, c’est-à-dire quasiment une contradiction dans les termes. Si institution signifie forme stable, et minorité variation ou devenir, on peut formuler ce problème de diverses manières : Comment ordonner des usages sans les standardiser ? Comment faire durer un mouvement sans le figer, comment donner forme à des forces sans les détruire ?
Bref, comment instituer du devenir ?
Puis, c’est au tour de Coline Z. de parler de récupération, et de destitution, et même d’auto-destitution, comme préalable à d’autres alternatives, pour créer des groupe-sujets, de l’inconscient collectif, de l’autonomie, de la justice. C’est le mouvement, le devenir, le laisser mourir ou le fait même d’accepter de ne pas durer, qui soudent, défont, re-soudent des groupes qui souhaitent ne pas trahir leur projet, rester engagés, continuer à penser, à agir, à subsister ? Selon Bourdieu, citons p.154 : Le travail micropolitique, en tant qu’il œuvre à la transversalité d’un groupe, est une façon de lutter contre la récupération. Je souligne néanmoins que la proposition de Félix Guattari déplace l’idée de micropolitique, telle qu’on l’entend habituellement. Celle qu’il propose a trait à la découverte des contenus latents, du désir, de la subjectivité sociale inconsciente qui circule plus ou moins, plutôt que la dé-construction frontale des structures de pouvoir et rapports de domination qui traversent un groupe. Ceux-ci, néanmoins, entravent sa transversalité et seule la transversalité d’un groupe permet au désir de vraiment circuler. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne s’agit pas de déconstruire frontalement les rapports de domination et les structures de pouvoir, mais de débusquer le désir, la subjectivité sociale et ce qui les coince en considérant les groupes comme des sujets à part entière.
Cultiver le désir et la capacité d’action : façon d’envisager le travail micropolitique d’une façon qui me semble moins morale et plus désirable que celle qu’on pratique habituellement dans les milieux anti-autoritaires. Pour le dire avec les mots de François Tosquelles, le fondateur de la psychothérapie institutionnelle : il s’agit de se brancher sur l’inconscient plutôt que sur la prise de conscience des rapports de domination. (…) Considérer le groupe comme sujet revient donc à questionner les structures qui font émerger tel comportement individuel, plutôt que de ramener celui-ci à la psychologie de la personne. C’est un rapport inversé à la psychologie : une psychanalyse du sujet dans laquelle on considère que c’est le groupe qui est sujet, et non l’individu.
Si les institutions sont notre milieu d’évolution, le milieu dans lequel on baigne, comment y créer les conditions d’un travail analytique du sujet social inconscient ? « Sans répit, chaque problème devait être repris, rediscuté, propose Félix Guattari. Également Psychiatre et co-créateur de la clinique de La Borde, Jean Oury dit à sa façon, qui est la sienne, qu’il faut ouvrir « cette chose difficile que j’appelle “espace du dire”, cette possibilité de rencontre, de transfert où puisses’exprimer quelque chose de l’ordre de ce qui habituellement est considéré comme inexprimable ».
C’est-à-dire qu’il faut de l’espace, du vide, pour « faire leur place au non-sens, à la parole vide », à ce qui ne veut pas être entendu. Cela requiert une attention, une disponibilité, pour que les non-dits, les ruptures de sens, les inhibitions, les angoisses, non seulement trouvent à s’exprimer, mais surtout soient entendues. Cette lucidité existe toujours, à différents degrés, mais éclatée, dispersée et confinée en chacun·e des membres et parfois des personnes moins proches, elle sourd en permanence autour des machines à café, dans les couloirs, les embrasures, les halls d’immeubles (…)
Guattari décrit ces espaces comme des « vacuoles analytiques ». En biologie, une vacuole désigne un petit compartiment à l’intérieur des cellules, qui n’a pas de forme ou de taille particulière, celles-ci variant en fonction des besoins de la cellule. Ces fonctions sont : la gestion des déchets à l’aide d’enzymes de digestion, le maintien de l’équilibre hydrique et de la pression cellulaire. Il en va de même en socioanalyse. Les vacuoles peuvent se constituer dans les couloirs, ou autour de la machine à café. La vacuole analytique n’a pas besoin d’être formalisée. ” (cité de Irrécupérables VI-4 – Vacuole analytique, p.152).
À l’oreille
- Juliette Laso – Mujer / Tribus / Corazón Lobo
- Steve Reich – Clapping music
- Béla Bartòk – Chant de recrutement
Voix off
- extrait du Grand-Entretien de Félix Guattari (1989)
- extrait de Petits métrages avec Jean Oury – Qu’est-ce que tu fous-là (1977)
- extrait de La Borde, droits à la folie avec Félix Guattari (1977)
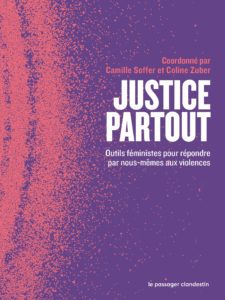
Pour aller plus loin
- École de philosophie
- Éditions BURN~AOÛT
- Ce qui tient, réflexions sur les institutions mineures
- Justice partout, Pour une justice transformatrice
de Camille Soffer et Coline Zuber – aux éditions Le Passager clandestin
Outils féministes pour répondre par nous-mêmes aux violences.
À voir
- Les heures heureuses, de Martine Deyres – Hôpital de Saint-Alban – 2019
- La Borde ou le droit à la folie, d’Igor Barrère – 1977
- École Pajol, le film, prod. Nos Rêves d’enfants – 2025
Pour écouter Théo des éditions BURN~AOÛT, invité pour l’émission Éditions, luttes, indépendances ? Face à l’empire Bolloré, se disperser ? C’est là : Comm’un vendredi #14
Sauf mention contraire et autres licences applicables cette œuvre sonore de Cause Commune est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.